Marivaux
3 participants
Books en Stock :: Hey Billie Y'a quoi dans ta bibliothèque ? :: Littérature française :: Auteurs nés avant 1870
Page 1 sur 1
 Marivaux
Marivaux
Marivaux (1668 - 1763)
Source : Wikipédia
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, plus connu sous le nom de Marivaux, né le 4 février 1688 et baptisé le 8 février 1688 à Paris où il meurt le 12 février 1763, est un écrivain français.
Homme solitaire et discret à la personnalité susceptible, longtemps incompris, il fut un journaliste, un romancier, mais surtout un dramaturge des Lumières, amoureux du théâtre et de la vérité, qui observait en spectateur lucide le monde en pleine évolution, et qui écrivit pour les Comédiens italiens, entre 1722 et 1740, des comédies sur mesure et d’un ton nouveau, dans le langage « de la conversation ». Au 1er septembre 2009, il est le 5e auteur le plus joué par la Comédie-Française.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
La double inconstance
Créée en 1723 par les Comédiens Italiens, comme la plupart des comédies de Marivaux, c'est une des pièces parmi les jouées et étudiées de son auteur. Elle est en trois actes et en prose.
Sylvia, une jeune paysanne, a été enlevée par le prince, qui veut l'épouser. Mais Sylvia est fiancée à Arlequin, elle l'aime et ne veut pas entendre parler du prince, qu'elle pense n'avoir jamais rencontré. Arlequin est aussi amené au château, il réclame de pouvoir épouser Sylvia et rentrer chez lui. le prince se désespère : il ne veut personne d'autre que Sylvia, qu'il a rencontré en se baladant incognito. La fille d'un domestique, Flaminia, va essayer de manipuler les deux jeunes gens, qui sont autorisés à se voir. le prince va courtiser Sylvia sans avoir l'air de le faire sous les traits d'un jeune officier, et Flaminia, sous prétexte de soutenir l'amour d'Arlequin, va essayer de lui faire oublier Sylvia.
C'est très simple et complexe à la fois, comme toujours chez Marivaux. L'intrigue à proprement parlé peut se résumer en un petit paragraphe, alors qu'on écrit des volumes entiers d'analyse sur la pièce. J'ai envie de parler d'un aspect pas toujours mis en avant en premier, celui du jeu de la tentation. Arlequin et Sylvia sont soumis à une tentation, si on veut faire savant, d'une tentation de second ordre d'après la définition de St Augustin, celle dans laquelle il y a déception ou séduction, la sollicitation d'un agent corrupteur. Cet agent corrupteur propose de transgresser un interdit, un loi morale, et provoque donc un conflit psychique chez l'individu soumis à la tentation. Et il s'avère impossible d'y résister. Mais il faut que le corrupteur soit suffisamment habile pour sauvegarder les apparences, laisser au tenté l'illusion qu'il ne trahit pas ses principes, pour qu'il puisse ne pas perdre l'estime de lui-même, une illusion, un mensonge se construit à deux.
Mais il y a une dissymétrie fondamentale : Arlequin et Sylvia sont des simples paysans, et ils ont à faire à un prince, et à toute une cour qui cherche à les tenter. Sous les allures délicates et subtiles il y a une vraie violence : Sylvia a été enlevée, elle n'est pas là de son propre gré. L'art consiste ensuite à lui faire dire qu'elle a envie d'y rester, et à persuader Arlequin de donner son accord. de les rendre complices en somme. Il y a une opposition énoncée au départ, entre les faux semblants, les fausses valeurs de la cour, et la sincérité, l'honnêteté des jeunes paysans, qui plutôt que des biens et les possessions jugés dérisoires, préfèrent l'amour vrai et authentique. C'est à cela finalement qu'ils doivent renoncer, en succombant à un nouvel partenaire, et en abandonnant l'ancien. On peut se demander combien de temps le prince va trouver amusante cette petite paysanne qu'il s'est donné le caprice d'épouser, et combien de temps Flaminia va s'amuser du naturel d'Arlequin.
Je ne suis pas sûre que le terme de comédie convienne forcément si bien à Marivaux.
Créée en 1723 par les Comédiens Italiens, comme la plupart des comédies de Marivaux, c'est une des pièces parmi les jouées et étudiées de son auteur. Elle est en trois actes et en prose.
Sylvia, une jeune paysanne, a été enlevée par le prince, qui veut l'épouser. Mais Sylvia est fiancée à Arlequin, elle l'aime et ne veut pas entendre parler du prince, qu'elle pense n'avoir jamais rencontré. Arlequin est aussi amené au château, il réclame de pouvoir épouser Sylvia et rentrer chez lui. le prince se désespère : il ne veut personne d'autre que Sylvia, qu'il a rencontré en se baladant incognito. La fille d'un domestique, Flaminia, va essayer de manipuler les deux jeunes gens, qui sont autorisés à se voir. le prince va courtiser Sylvia sans avoir l'air de le faire sous les traits d'un jeune officier, et Flaminia, sous prétexte de soutenir l'amour d'Arlequin, va essayer de lui faire oublier Sylvia.
C'est très simple et complexe à la fois, comme toujours chez Marivaux. L'intrigue à proprement parlé peut se résumer en un petit paragraphe, alors qu'on écrit des volumes entiers d'analyse sur la pièce. J'ai envie de parler d'un aspect pas toujours mis en avant en premier, celui du jeu de la tentation. Arlequin et Sylvia sont soumis à une tentation, si on veut faire savant, d'une tentation de second ordre d'après la définition de St Augustin, celle dans laquelle il y a déception ou séduction, la sollicitation d'un agent corrupteur. Cet agent corrupteur propose de transgresser un interdit, un loi morale, et provoque donc un conflit psychique chez l'individu soumis à la tentation. Et il s'avère impossible d'y résister. Mais il faut que le corrupteur soit suffisamment habile pour sauvegarder les apparences, laisser au tenté l'illusion qu'il ne trahit pas ses principes, pour qu'il puisse ne pas perdre l'estime de lui-même, une illusion, un mensonge se construit à deux.
Mais il y a une dissymétrie fondamentale : Arlequin et Sylvia sont des simples paysans, et ils ont à faire à un prince, et à toute une cour qui cherche à les tenter. Sous les allures délicates et subtiles il y a une vraie violence : Sylvia a été enlevée, elle n'est pas là de son propre gré. L'art consiste ensuite à lui faire dire qu'elle a envie d'y rester, et à persuader Arlequin de donner son accord. de les rendre complices en somme. Il y a une opposition énoncée au départ, entre les faux semblants, les fausses valeurs de la cour, et la sincérité, l'honnêteté des jeunes paysans, qui plutôt que des biens et les possessions jugés dérisoires, préfèrent l'amour vrai et authentique. C'est à cela finalement qu'ils doivent renoncer, en succombant à un nouvel partenaire, et en abandonnant l'ancien. On peut se demander combien de temps le prince va trouver amusante cette petite paysanne qu'il s'est donné le caprice d'épouser, et combien de temps Flaminia va s'amuser du naturel d'Arlequin.
Je ne suis pas sûre que le terme de comédie convienne forcément si bien à Marivaux.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Les fausses confidences
Créée en 1737 sous le titre de la Fausse confidence à l'hôtel de Bourgogne par les Comédiens Italiens, la pièce eût peu de succès dans un premier temps. Une reprise l'année suivante, sous son nom définitif de Fausses confidences permit à la pièce de s'imposer. Elle sera mise au répertoire de la Comédie Française en 1793, en pleine Révolution et fait partie des pièces les plus fréquemment jouées de Marivaux. C'est la dernière grande pièce de l'auteur, il n'écrira plus par la suite que des pièces en un acte.
De nombreuses sources sont citées pour l'intrigue des Fausses confidences : La Fontaine de la jeune veuve, Lope de Vega dont la pièce le chien du jardinier venait d'être déjà adaptée par les Comédiens Italiens et dont la trame rappelle sur plusieurs points Les fausses Confidences. Il y aussi le roman de Marivaux, le paysans parvenu, dont le personnage principal, Jacob, épouse une riche veuve dont il a été le domestique. Même si personne ne la cite, il y a aussi la comédie de Corneille, La suivante, dans laquelle des jeunes gens courtisent la dame de compagnie d'une jeune héritière pour se rapprocher en réalité de cette dernière et de son héritage. La notion de ruses amoureuses et de tromperies diverses pour séduire une dame fortunée et s'élever dans l'échelle sociale semble dans l'air du temps.
Dorante un jeune homme de bonne famille, mais ruiné, s'apprête à postuler pour un emploi d'intendant chez une riche veuve, Araminte. Il est soutenu par son oncle, Monsieur Rémy, procureur de son état, et par Dubois, son ancien valet, passé au service d'Araminte. Ce dernier a en tête toute une stratégie, pour que Dorante puisse séduire et épouser Araminte. Dans un premier temps, Dorante paraît plutôt s'intéresser à Marton, la suivante d'Araminte, qui peut l'aider à être recruté, malgré un autre candidat. Une fois choisi, Dubois, révèle à Araminte que Dorante l'aime depuis des mois. Tout une série de petits incidents, entre portraits ou lettres égarées, confortent Araminte dans cette idée. Mais elle a un soupirant officiel, appuyé par sa mère, un comte. Ce mariage pourrait éviter un procès, toujours coûteux et incertain. Mais visiblement le comte ne séduit pas vraiment Araminte. Elle est prise petit à petit dans le jeu de Dubois, et n'arrive pas à se décider à renvoyer Dorante, malgré les sentiments supposés de ce dernier, qui perturbent ses plans matrimoniaux et l'hostilité de sa mère. La pièce s'achemine progressivement vers sa fin, et les aveux inévitables.
Une pièce d'une grande ambiguïté. Au final, les sentiments réels de Dorante ne sont jamais certains : ce qui l'attire vers Araminte est-ce l'amour ou l'intérêt avant tout ? Dans quelle proportion l'un ou l'autre ? le sait-il d'ailleurs lui-même ? Où s'arrête le jeu, le faux-semblant et où se trouve la sincérité ? Araminte elle aussi joue avec Dorante, essaie de tester ses sentiments, lui fait elle aussi des semblants de confidences sur ses projets de mariage par exemple, dont on pressent les mensonges. Mais elle est seule en face de plusieurs joueurs ligués contre elle. Elle est prise également par son amour propre : ce jeune homme séduisant, qu'au moins deux autres femmes semblent vouloir épouser, est une prise de choix. Etre abandonnée serait un coup d'épingle pour sa fierté.
Nous sommes dans un univers dans lequel les unions sont déterminées par les intérêts financiers, par la familles, ce ne sont pas des choix individuels basés sur les sentiments. Araminte est dans la seule situation dans lequelle le choix du mari appartient à la femme : elle est veuve. Mais le choix lui appartient-il vraiment, compte tenu de la manipulation dont elle-elle victime ?
Une fois encore, c'est un valet qui mène le jeu, Dubois, et qui arrive à l'objectif du mariage. Ici l'obstacle n'est pas un père ou tuteur, mais la femme elle-même, qui au départ n'a aucune raison d'épouser un jeune homme inconnu, dont les motivations restent pour le moins troubles. Dorante ne compte pas, pour conquérir l'amour d'Araminte, sur sa sincérité, la force de son sentiments, ses qualités, mais sur la ruse de son valet, qui semble presque plus décidé à faire aboutir le mariage que son maître. Dubois est une sorte de marionnettiste qui fait agir les protagonistes, Dorante semble suivre sa partition d'une façon docile, jusqu'à la scène finale, et même là agit-il sur ordre ? Ou son valet a prévu sa réaction et ses conséquences ?
La pièce finie, il demeure plus de questions que de réponses, sur les personnages et leurs motivations. Une sorte de malaise aussi. Mais un grand plaisir, d'avoir suivi une oeuvre brillante, intelligente, et d'une grande profondeur.
Créée en 1737 sous le titre de la Fausse confidence à l'hôtel de Bourgogne par les Comédiens Italiens, la pièce eût peu de succès dans un premier temps. Une reprise l'année suivante, sous son nom définitif de Fausses confidences permit à la pièce de s'imposer. Elle sera mise au répertoire de la Comédie Française en 1793, en pleine Révolution et fait partie des pièces les plus fréquemment jouées de Marivaux. C'est la dernière grande pièce de l'auteur, il n'écrira plus par la suite que des pièces en un acte.
De nombreuses sources sont citées pour l'intrigue des Fausses confidences : La Fontaine de la jeune veuve, Lope de Vega dont la pièce le chien du jardinier venait d'être déjà adaptée par les Comédiens Italiens et dont la trame rappelle sur plusieurs points Les fausses Confidences. Il y aussi le roman de Marivaux, le paysans parvenu, dont le personnage principal, Jacob, épouse une riche veuve dont il a été le domestique. Même si personne ne la cite, il y a aussi la comédie de Corneille, La suivante, dans laquelle des jeunes gens courtisent la dame de compagnie d'une jeune héritière pour se rapprocher en réalité de cette dernière et de son héritage. La notion de ruses amoureuses et de tromperies diverses pour séduire une dame fortunée et s'élever dans l'échelle sociale semble dans l'air du temps.
Dorante un jeune homme de bonne famille, mais ruiné, s'apprête à postuler pour un emploi d'intendant chez une riche veuve, Araminte. Il est soutenu par son oncle, Monsieur Rémy, procureur de son état, et par Dubois, son ancien valet, passé au service d'Araminte. Ce dernier a en tête toute une stratégie, pour que Dorante puisse séduire et épouser Araminte. Dans un premier temps, Dorante paraît plutôt s'intéresser à Marton, la suivante d'Araminte, qui peut l'aider à être recruté, malgré un autre candidat. Une fois choisi, Dubois, révèle à Araminte que Dorante l'aime depuis des mois. Tout une série de petits incidents, entre portraits ou lettres égarées, confortent Araminte dans cette idée. Mais elle a un soupirant officiel, appuyé par sa mère, un comte. Ce mariage pourrait éviter un procès, toujours coûteux et incertain. Mais visiblement le comte ne séduit pas vraiment Araminte. Elle est prise petit à petit dans le jeu de Dubois, et n'arrive pas à se décider à renvoyer Dorante, malgré les sentiments supposés de ce dernier, qui perturbent ses plans matrimoniaux et l'hostilité de sa mère. La pièce s'achemine progressivement vers sa fin, et les aveux inévitables.
Une pièce d'une grande ambiguïté. Au final, les sentiments réels de Dorante ne sont jamais certains : ce qui l'attire vers Araminte est-ce l'amour ou l'intérêt avant tout ? Dans quelle proportion l'un ou l'autre ? le sait-il d'ailleurs lui-même ? Où s'arrête le jeu, le faux-semblant et où se trouve la sincérité ? Araminte elle aussi joue avec Dorante, essaie de tester ses sentiments, lui fait elle aussi des semblants de confidences sur ses projets de mariage par exemple, dont on pressent les mensonges. Mais elle est seule en face de plusieurs joueurs ligués contre elle. Elle est prise également par son amour propre : ce jeune homme séduisant, qu'au moins deux autres femmes semblent vouloir épouser, est une prise de choix. Etre abandonnée serait un coup d'épingle pour sa fierté.
Nous sommes dans un univers dans lequel les unions sont déterminées par les intérêts financiers, par la familles, ce ne sont pas des choix individuels basés sur les sentiments. Araminte est dans la seule situation dans lequelle le choix du mari appartient à la femme : elle est veuve. Mais le choix lui appartient-il vraiment, compte tenu de la manipulation dont elle-elle victime ?
Une fois encore, c'est un valet qui mène le jeu, Dubois, et qui arrive à l'objectif du mariage. Ici l'obstacle n'est pas un père ou tuteur, mais la femme elle-même, qui au départ n'a aucune raison d'épouser un jeune homme inconnu, dont les motivations restent pour le moins troubles. Dorante ne compte pas, pour conquérir l'amour d'Araminte, sur sa sincérité, la force de son sentiments, ses qualités, mais sur la ruse de son valet, qui semble presque plus décidé à faire aboutir le mariage que son maître. Dubois est une sorte de marionnettiste qui fait agir les protagonistes, Dorante semble suivre sa partition d'une façon docile, jusqu'à la scène finale, et même là agit-il sur ordre ? Ou son valet a prévu sa réaction et ses conséquences ?
La pièce finie, il demeure plus de questions que de réponses, sur les personnages et leurs motivations. Une sorte de malaise aussi. Mais un grand plaisir, d'avoir suivi une oeuvre brillante, intelligente, et d'une grande profondeur.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
En complément, on peut voir un film de Luc Bondy filmant les Fausses confidences, avec Isabelle Huppert et Louis Garrel :https://vimeo.com/402932046
Il y a aussi une série d'émissions sur France Culture en podcast : là
Je conseille très fort le troisième épisode, avec le grand Jacques Lassalle, qui en parle avec une intelligence et sensibilité rare.
Il y a aussi une série d'émissions sur France Culture en podcast : là
Je conseille très fort le troisième épisode, avec le grand Jacques Lassalle, qui en parle avec une intelligence et sensibilité rare.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Merci @arabella pour ce rappel, je l'avais noté mais pas encore pris le temps de me mettre devant. Je ne suis pas trop tentée par la lecture de pièces de théâtre mais je vais sûrement regarder cette pièce, j'aime beaucoup Marivaux !!Arabella a écrit:En complément, on peut voir un film de Luc Bondy filmant les Fausses confidences, avec Isabelle Huppert et Louis Garrel :https://vimeo.com/402932046
Il y a aussi une série d'émissions sur France Culture en podcast : là
Je conseille très fort le troisième épisode, avec le grand Jacques Lassalle, qui en parle avec une intelligence et sensibilité rare.
_________________
"Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux" Jules Renard

Liseron- Messages : 4182
Date d'inscription : 02/01/2017
Localisation : Toulouse
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Quel régal que le film de Luc Bondy ! La mise en scène est d'une grande originalité et les acteurs excellents. Un faible pour Isabelle Huppert, grande classe même en survêtement doré sur son tapis de course !! Au final, effectivement, il reste beaucoup de questions, le sujet n'est pas si léger que cela mais on se sera bien amusés !
A regarder absolument avant la fin du confinement !
A regarder absolument avant la fin du confinement !
_________________
"Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux" Jules Renard

Liseron- Messages : 4182
Date d'inscription : 02/01/2017
Localisation : Toulouse
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Oh je n'avais pas vu ça! Excellent.Arabella a écrit:En complément, on peut voir un film de Luc Bondy filmant les Fausses confidences, avec Isabelle Huppert et Louis Garrel :https://vimeo.com/402932046
Je me régale déjà avec les pièces données par la Comedie française .
- Spoiler:
- Vu Le Misanthrope, très bon mais j'ai raté Vania lundi. On peut les revoir je pense. Dom Juan ce soir, Lorenzaccio demain...quel festival !!

Aeriale- Messages : 11633
Date d'inscription : 30/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
J'ai beaucoup aimé ce film de Luc Bondy, effectivement Isabelle Huppert est top, et je suis sûre qu'Aeriale sera sensible au charme de Louis GarreL.
Le Dom Juan de Jacques Lassalle
Vania j'avais adoré.
J'attends de découvrir Lorenzaccio.
Finalement, on est très occupé pendant le confinement.
Le Dom Juan de Jacques Lassalle

Vania j'avais adoré.
J'attends de découvrir Lorenzaccio.
Finalement, on est très occupé pendant le confinement.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Le jeu de l'amour et du hasard
Créée en 1730 au théâtre des Italiens, entrée en 1795 au répertoire de la Comédie Française et reprise régulièrement au XIXe siècle, c'est peut-être la pièce la plus célèbre de son auteur, si on s'en tient au nombre de mises en scène et représentations.
Orgon, le père de Sylvia, lui annonce que le jeune homme qu'il souhaite la voir épouser, Dorante, va bientôt venir lui faire sa cour. Sylvia lui demande de pouvoir observer son promis sous l'habit de sa soubrette Lisette, pendant que celui-ci fera semblant d'être Sylvia. Cette dernière pense pouvoir ainsi être sûre de voir qui est vraiment Dorante et si elle pourra être heureuse avec lui. Mais de son côté, Dorante use du même stratagème, et se présente sous l'habit de Bourguignon, un valet, pendant qu'Arlequin, son serviteur, joue le maître. Dorante et son fils Mario sont au courant de la double substitution et s'en amusent, pendant que les quatre jeunes gens vivent les affres des sentiments, trompés par les habits d'emprunts des uns et des autres.
Le déguisement du valet en maître et vice-versa est un ressort de comédie déjà apparu dans le théâtre antique, et repris abondamment dans le théâtre classique français, en particulier en imitation de la comédie espagnole. L'acteur comique le plus célèbre avant Molière, Jodelet, s'en est fait une spécialité, et lorsqu'il rejoindra la troupe de Molière à la fin de sa vie, ce dernier écrira en partie pour lui les Précieuses ridicules, pièce dans laquelle il pourra, avec un succès phénoménal jouer un valet déguisé en vicomte de Jodelet. Ce sera sa dernière pièce, et le premier triomphe de Molière dans la capitale.
Mais Marivaux imagine un double déguisement, la jeune fille rejoignant le jeune homme dans la démarche d'observation, ce qui met en quelque sorte les deux sexes à égalité : ils ont les mêmes interrogations, la même légitimité à se poser les questions sur le choix de leur futur conjoint et recourent au même stratagème pour être fixés. Malgré tout, ce double déguisement, que chacun croit unique, ne donne à chaque fiancé que l'illusion de maîtriser la situation : c'est au final Orgon, qui par la connaissance qu'il en a, qui tire les ficelles, qui est le plus à même de suivre les événements en leur donnant leur véritable sens et qui peut orienter le cours des choses, les rôles choisis par Sylvia et Dorante limitant leurs marges de manoeuvres, et leur ignorance de l'identité de deux autres protagonistes ne peut que les précipiter dans un jeu d'erreurs, sur les autres et sur eux-mêmes.
D'une façon sans doute rassurante pour les spectateurs de l'époque, Arlequin, avec son comportement de « valet » déplaît à Sylvia et séduit Lisette. de même, Dorante, sous son habit de valet séduit et est séduit par Sylvia. Une sorte de légitimation du mariage entre les semblables socialement, décidé par les pères. Même si les maîtres et valet changent d'habits, il est plus difficile de changer en un instant le comportement, la façon de parler, ce qu'on appellerait aujourd'hui les codes sociaux. Parce que c'est essentiellement cela que nos jeunes gens voient de l'autre, ils ont assez peu l'occasion dans la pièce d'éprouver d'autres caractéristiques, plus personnels de leurs partenaires potentiels. La pièce soulève l'interrogation de savoir ce que l'on aime dans l'autre, quels sont les éléments qui déterminent la naissance des sentiments, l'envie de former un couple, et elle pointe les déterminismes sociaux, même lorsqu'on pense pouvoir y échapper. Une célèbre enquête d'Alain Girard datant de 1959 avait démontrée une forte homogamie sociale, c'est dire le choix d'un partenaire socialement proche. Les choses n'ont pas tellement changées actuellement, l'apparente liberté de choix aboutit finalement à une forme de reproduction sociale, alors que notre société affirme la priorité du sentiment comme critère du choix du partenaire. . Marivaux pointait déjà ce mécanisme, dans un monde qui imposait le mariage du semblable avec le semblable : même sans contrainte, c'est cela qui va se produire le plus généralement.
Créée en 1730 au théâtre des Italiens, entrée en 1795 au répertoire de la Comédie Française et reprise régulièrement au XIXe siècle, c'est peut-être la pièce la plus célèbre de son auteur, si on s'en tient au nombre de mises en scène et représentations.
Orgon, le père de Sylvia, lui annonce que le jeune homme qu'il souhaite la voir épouser, Dorante, va bientôt venir lui faire sa cour. Sylvia lui demande de pouvoir observer son promis sous l'habit de sa soubrette Lisette, pendant que celui-ci fera semblant d'être Sylvia. Cette dernière pense pouvoir ainsi être sûre de voir qui est vraiment Dorante et si elle pourra être heureuse avec lui. Mais de son côté, Dorante use du même stratagème, et se présente sous l'habit de Bourguignon, un valet, pendant qu'Arlequin, son serviteur, joue le maître. Dorante et son fils Mario sont au courant de la double substitution et s'en amusent, pendant que les quatre jeunes gens vivent les affres des sentiments, trompés par les habits d'emprunts des uns et des autres.
Le déguisement du valet en maître et vice-versa est un ressort de comédie déjà apparu dans le théâtre antique, et repris abondamment dans le théâtre classique français, en particulier en imitation de la comédie espagnole. L'acteur comique le plus célèbre avant Molière, Jodelet, s'en est fait une spécialité, et lorsqu'il rejoindra la troupe de Molière à la fin de sa vie, ce dernier écrira en partie pour lui les Précieuses ridicules, pièce dans laquelle il pourra, avec un succès phénoménal jouer un valet déguisé en vicomte de Jodelet. Ce sera sa dernière pièce, et le premier triomphe de Molière dans la capitale.
Mais Marivaux imagine un double déguisement, la jeune fille rejoignant le jeune homme dans la démarche d'observation, ce qui met en quelque sorte les deux sexes à égalité : ils ont les mêmes interrogations, la même légitimité à se poser les questions sur le choix de leur futur conjoint et recourent au même stratagème pour être fixés. Malgré tout, ce double déguisement, que chacun croit unique, ne donne à chaque fiancé que l'illusion de maîtriser la situation : c'est au final Orgon, qui par la connaissance qu'il en a, qui tire les ficelles, qui est le plus à même de suivre les événements en leur donnant leur véritable sens et qui peut orienter le cours des choses, les rôles choisis par Sylvia et Dorante limitant leurs marges de manoeuvres, et leur ignorance de l'identité de deux autres protagonistes ne peut que les précipiter dans un jeu d'erreurs, sur les autres et sur eux-mêmes.
D'une façon sans doute rassurante pour les spectateurs de l'époque, Arlequin, avec son comportement de « valet » déplaît à Sylvia et séduit Lisette. de même, Dorante, sous son habit de valet séduit et est séduit par Sylvia. Une sorte de légitimation du mariage entre les semblables socialement, décidé par les pères. Même si les maîtres et valet changent d'habits, il est plus difficile de changer en un instant le comportement, la façon de parler, ce qu'on appellerait aujourd'hui les codes sociaux. Parce que c'est essentiellement cela que nos jeunes gens voient de l'autre, ils ont assez peu l'occasion dans la pièce d'éprouver d'autres caractéristiques, plus personnels de leurs partenaires potentiels. La pièce soulève l'interrogation de savoir ce que l'on aime dans l'autre, quels sont les éléments qui déterminent la naissance des sentiments, l'envie de former un couple, et elle pointe les déterminismes sociaux, même lorsqu'on pense pouvoir y échapper. Une célèbre enquête d'Alain Girard datant de 1959 avait démontrée une forte homogamie sociale, c'est dire le choix d'un partenaire socialement proche. Les choses n'ont pas tellement changées actuellement, l'apparente liberté de choix aboutit finalement à une forme de reproduction sociale, alors que notre société affirme la priorité du sentiment comme critère du choix du partenaire. . Marivaux pointait déjà ce mécanisme, dans un monde qui imposait le mariage du semblable avec le semblable : même sans contrainte, c'est cela qui va se produire le plus généralement.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
Merci pour ton topo très intéressant, Arabella.
Une pièce que j'ai vue il y a très longtemps, j'aimerais bien la lire.
Une pièce que j'ai vue il y a très longtemps, j'aimerais bien la lire.

Aeriale- Messages : 11633
Date d'inscription : 30/11/2016
 Re: Marivaux
Re: Marivaux
La vie de Marianne
Marivaux a fait paraître ce texte en livraisons successives entre 1731 et 1742, tout en écrivant par ailleurs un autre roman, le paysan parvenu, plusieurs pièces de théâtre, et le cabinet du Philosophe, que certains considèrent comme un véritable atelier du roman, une réflexion sur certains changements esthétiques qui appellent la mise en place de dispositifs narratifs et fictionnels nouveaux permettant de les traduire dans un nouveau discours romanesque, au service des attentes du public. C'est dans les romans écrits à la même époque que ces nouveaux principes sont mis en application.
La vie de Marianne appartient au genre du roman-mémoires. le roman de Madame de Villedieu publié en 1671, les Mémoires d'Henriette-Sylvie de Molière est considéré comme le premier roman notable relevant de ce genre. Dans ce genre romanesque, un personnage fictif fait un récit à la première personne de sa vie . Il ne s'agit pas de donner un récit de faits historiques, mais de s'interroger sur soi-même, sur son parcours ;ces romans sont souvent centrés sur la vie sentimentale des personnages. le récit à la première personne est censé donner un caractère d'authenticité au texte, les auteurs insistent souvent sur cet aspect.
Le roman de Marivaux utilise aussi une autre forme romanesque relativement récente, celle du roman épistolaire. le texte du roman, miraculeusement retrouvé par un éditeur dans une maison qu'il vient d'acheter, est constitué par des lettres, qu'une comtesse aurait écrites à une amie pour lui raconter son existence atypique. Nous n'avons pas les réponses de l'amie, mais la forme épistolaire permet à Marivaux d'interrompre son roman à certains moments, suivant les contraintes des parutions, et il permet une structuration souple, des digressions un peu comme dans une conversation avec une amie.
Marianne a donc connu un début d'existence mouvementé : âgée d'environ deux ans, elle a été retrouvée par des militaires dans un carrosse, dont tous les autres occupants ont été tués par des brigands, qui les ont dépouillé. L'identité de la petite fille est totalement inconnue et incertaine. Elle est prise en charge par le curé de village et sa soeur, bonnes gens modestes. Mais lors d'un voyage à Paris au chevet d'un parent, dont la soeur de curé espère un héritage pour sa protégée, le curé et la soeur décèdent, et la jeune femme se retrouve dans la capitale seule et sans ressources. Elle sollicite un religieux, qui était en lien avec sa mère adoptive, et celui-ci la confie aux bons soins d'un dévot, M. de Climal. Ce dernier est en réalité un hypocrite : il souhaite profiter de la situation de Marianne pour en faire sa maîtresse. Il la place chez une lingère, où elle fait son apprentissage, et lui fait des cadeaux généreux. Marianne ne comprend pas dans un premier temps la situation, ou peut-être préfère ne pas la comprendre, mais cela devient de plus en plus difficile, M. de Climal devenant de plus en plus explicite sur ses intentions. Marianne se refuse à les accepter, tout en essayant de ne pas le froisser pour ne pas se retrouver à la rue. Elle fait la connaissance à l'église d'un beau jeune homme, Valville qui l'accueille chez lui suite à une entorse. Il s'avère être le neveu de M. de Climal. Ce dernier devient plus que pressant, et Marianne quitte sa lingère pour se réfugier dans un couvent, dans lequel elle ferra la connaissance d'une dame noble et riche, qui la prendra sous sa protection et deviendra une véritable mère adoptive pour elle. Comme nous sommes dans un roman, cette Mme de Miran se révèle être la mère de Valville, et très vite elle est d'accord pour un mariage. Mais des parents puissants ne l'entendent pas de cette oreille : Marianne est enlevée, on veut lui faire épouser un autre homme de force. Les choses s'arrangent, mais Valville se montre inconstant, tombe amoureux d'une autre jeune femme, dont le rang social correspond davantage au sien. Qu'importe : un autre homme, lui aussi riche et noble, propose à Marianne de l'épouser. Entre temps, elle écoute la confession d'une religieuse, Trevire, dont la destinée ne semble pas plus simple que celle de Marianne. Nous ne saurons pas la fin de son histoire, ni comment elle est devenue religieuse. Et le roman s'achève, ne reprend pas l'histoire de Marianne. Nous ne saurons pas si elle a pu connaître son identité, si elle s'est mariée et avec qui, tous les scénarii sont possibles. Nous savons juste que vers 50 ans elle est comtesse et riche.
Le récit à proprement parlé (dont les événements se résument au final à peu de choses, un des événements majeurs étant une entorse) est en permanence accompagné par des digressions, mais surtout par des réflexions et analyses. Marianne ne fait pas que raconter son histoire : elle analyse avec finesse et profondeur ce qui lui arrive, ses sentiments, ses ressentis, et en tire quelques généralités sur la nature humaine, même si elle le fait toujours avec légèreté et esprit. Elle est qualifiée par Marivaux de « Femme qui pense ». Elle oppose cette pensée qu'elle revendique dans le cours du texte, à celle des professionnels de la littérature et de la philosophie. Ces derniers obéissent à des règles, écrivent pour gagner leur vie, devant donner à leurs lecteurs ce qu'ils attendent, leurs productions ne sont pas forcément authentiques ni nées d'une nécessité intérieure. Marianne met en valeur sa liberté d'exposer en partant du récit de sa vie les pensées qu'elle fait naître en elle, sans aucune règle ni contrainte formelle.
Cette grand liberté de l'héroïne provient aussi de sa situation sociale. Elle est orpheline, ses origines sont inconnues. Or la société de l'époque est une société d'ordre, la naissance détermine le rang que l'on peut prétendre y occuper. Marianne n'a pas de place dans cet ordre, elle peut aussi bien être la fille de nobles parents que de la domestique. L'identité est donc l'enjeu du roman : pas celle héritée, donnée une fois pour toutes, mais une identité qui doit se construire à travers les expériences vécues et les réflexions qu'elles suscitent.
Marivaux a créé un personnage complexe : Marianne exprime avec force une aspiration à la dignité, refuse de se prostituer, de subir un mariage qui ne lui convient pas, mais en même temps elle fonctionne aussi dans une forme de séduction, devenant de plus en plus consciente du désir qu'elle suscite, de celui qu'elle ressent et des avantages qu'elle peut en tirer. le roman pose donc une question au coeur des préoccupations de son époque : comment concilier une noblesse morale avec le désir. de l'objet de désir, Marianne devient un sujet désirant, avec toutes les ambiguïtés : le trouble que fait naître l'amour fait peur mais en même temps éveille une attente, est un plaisir.
Marivaux se joue des stéréotypes de genre : les femmes sont bavardes, d'où les digressions de l'héroïne. Mais il procède à une sorte d'inversion : Marianne ne se limite pas aux faits, elle les analyse, élargit le cadre, tire des généralités de ses expériences. C'est parce qu'elle réfléchit, qu'elle est une femme qui pense, une pensée différente des philosophes professionnels, car tirée de l'expérience, du monde réel et non abstraite et théorique. Cela lui fait contester le privilège masculin qui voudrait qu'ils soient les seuls capables de philosopher. Elle oppose ce faisant une pensée sensible à une pensée théorique, coupée du réel. Son outil de réflexion est l'introspection, par un retour sur soi elle tente de rendre intelligible ce qui lui est arrivé, et en tirer une vision plus générale.
Marianne est à la fois l'observateur et l'observé, mais l'art de Marivaux va plus loin. Même si la Marianne de 50 ans a une lucidité, une distance qui lui permet d'expliciter des choses qui n'étaient pas claires pour la jeune Marianne, elle peut se tromper, ne pas tout voir, ou ne pas le vouloir. le lecteur à son tour peut se livrer aux jeux des interprétations, voyant ce que le personnage ignore, ce qui est suggéré par l'auteur. le livre pointe ainsi les limites de la lucidité appliquée à soi-même.
La forme romanesque est pour Marivaux la forme idéale pour explorer l'humanité dans ses conditions les plus variées, dont les plus modestes, souvent ignorées par la littérature de son époque. Une lingère est observée au même titre qu'une grande dame. Il s'agit d'explorer le coeur humain, sans tenir compte du prestige social, l'être humain est le même quelle que soit sa position dans la société. A ce titre, une orpheline à l'origine incertaine est un sujet idéal.
Beaucoup de choses ont été écrites, supputées sur l'inachèvement du roman. le manque d'une fin « classique » n'est pas accidentelle : Marivaux aurait eu le temps de l'écrire. Mais d'une certaine manière, terminer le livre, dire précisément ce qui est arrivé à Marianne, dévoiler ses origines, irait à l'encontre du projet du roman. C'est en racontant son histoire que Marianne construit son identité, qu'elle la fantasme à certains moments : une identité mouvante, en perpétuel remaniement, jamais achevée.
Au-delà de tous ces éléments d'analyse, c'est un roman délicieux, même si Marianne pense, elle est malicieuse, a le sens de l'humour, ne se prend pas au sérieux. Marivaux manie le second degré à la perfection et maîtrise l'art de conter, de surprendre, de tenir son lecteur en haleine, tout cela dans un style merveilleux.
Marivaux a fait paraître ce texte en livraisons successives entre 1731 et 1742, tout en écrivant par ailleurs un autre roman, le paysan parvenu, plusieurs pièces de théâtre, et le cabinet du Philosophe, que certains considèrent comme un véritable atelier du roman, une réflexion sur certains changements esthétiques qui appellent la mise en place de dispositifs narratifs et fictionnels nouveaux permettant de les traduire dans un nouveau discours romanesque, au service des attentes du public. C'est dans les romans écrits à la même époque que ces nouveaux principes sont mis en application.
La vie de Marianne appartient au genre du roman-mémoires. le roman de Madame de Villedieu publié en 1671, les Mémoires d'Henriette-Sylvie de Molière est considéré comme le premier roman notable relevant de ce genre. Dans ce genre romanesque, un personnage fictif fait un récit à la première personne de sa vie . Il ne s'agit pas de donner un récit de faits historiques, mais de s'interroger sur soi-même, sur son parcours ;ces romans sont souvent centrés sur la vie sentimentale des personnages. le récit à la première personne est censé donner un caractère d'authenticité au texte, les auteurs insistent souvent sur cet aspect.
Le roman de Marivaux utilise aussi une autre forme romanesque relativement récente, celle du roman épistolaire. le texte du roman, miraculeusement retrouvé par un éditeur dans une maison qu'il vient d'acheter, est constitué par des lettres, qu'une comtesse aurait écrites à une amie pour lui raconter son existence atypique. Nous n'avons pas les réponses de l'amie, mais la forme épistolaire permet à Marivaux d'interrompre son roman à certains moments, suivant les contraintes des parutions, et il permet une structuration souple, des digressions un peu comme dans une conversation avec une amie.
Marianne a donc connu un début d'existence mouvementé : âgée d'environ deux ans, elle a été retrouvée par des militaires dans un carrosse, dont tous les autres occupants ont été tués par des brigands, qui les ont dépouillé. L'identité de la petite fille est totalement inconnue et incertaine. Elle est prise en charge par le curé de village et sa soeur, bonnes gens modestes. Mais lors d'un voyage à Paris au chevet d'un parent, dont la soeur de curé espère un héritage pour sa protégée, le curé et la soeur décèdent, et la jeune femme se retrouve dans la capitale seule et sans ressources. Elle sollicite un religieux, qui était en lien avec sa mère adoptive, et celui-ci la confie aux bons soins d'un dévot, M. de Climal. Ce dernier est en réalité un hypocrite : il souhaite profiter de la situation de Marianne pour en faire sa maîtresse. Il la place chez une lingère, où elle fait son apprentissage, et lui fait des cadeaux généreux. Marianne ne comprend pas dans un premier temps la situation, ou peut-être préfère ne pas la comprendre, mais cela devient de plus en plus difficile, M. de Climal devenant de plus en plus explicite sur ses intentions. Marianne se refuse à les accepter, tout en essayant de ne pas le froisser pour ne pas se retrouver à la rue. Elle fait la connaissance à l'église d'un beau jeune homme, Valville qui l'accueille chez lui suite à une entorse. Il s'avère être le neveu de M. de Climal. Ce dernier devient plus que pressant, et Marianne quitte sa lingère pour se réfugier dans un couvent, dans lequel elle ferra la connaissance d'une dame noble et riche, qui la prendra sous sa protection et deviendra une véritable mère adoptive pour elle. Comme nous sommes dans un roman, cette Mme de Miran se révèle être la mère de Valville, et très vite elle est d'accord pour un mariage. Mais des parents puissants ne l'entendent pas de cette oreille : Marianne est enlevée, on veut lui faire épouser un autre homme de force. Les choses s'arrangent, mais Valville se montre inconstant, tombe amoureux d'une autre jeune femme, dont le rang social correspond davantage au sien. Qu'importe : un autre homme, lui aussi riche et noble, propose à Marianne de l'épouser. Entre temps, elle écoute la confession d'une religieuse, Trevire, dont la destinée ne semble pas plus simple que celle de Marianne. Nous ne saurons pas la fin de son histoire, ni comment elle est devenue religieuse. Et le roman s'achève, ne reprend pas l'histoire de Marianne. Nous ne saurons pas si elle a pu connaître son identité, si elle s'est mariée et avec qui, tous les scénarii sont possibles. Nous savons juste que vers 50 ans elle est comtesse et riche.
Le récit à proprement parlé (dont les événements se résument au final à peu de choses, un des événements majeurs étant une entorse) est en permanence accompagné par des digressions, mais surtout par des réflexions et analyses. Marianne ne fait pas que raconter son histoire : elle analyse avec finesse et profondeur ce qui lui arrive, ses sentiments, ses ressentis, et en tire quelques généralités sur la nature humaine, même si elle le fait toujours avec légèreté et esprit. Elle est qualifiée par Marivaux de « Femme qui pense ». Elle oppose cette pensée qu'elle revendique dans le cours du texte, à celle des professionnels de la littérature et de la philosophie. Ces derniers obéissent à des règles, écrivent pour gagner leur vie, devant donner à leurs lecteurs ce qu'ils attendent, leurs productions ne sont pas forcément authentiques ni nées d'une nécessité intérieure. Marianne met en valeur sa liberté d'exposer en partant du récit de sa vie les pensées qu'elle fait naître en elle, sans aucune règle ni contrainte formelle.
Cette grand liberté de l'héroïne provient aussi de sa situation sociale. Elle est orpheline, ses origines sont inconnues. Or la société de l'époque est une société d'ordre, la naissance détermine le rang que l'on peut prétendre y occuper. Marianne n'a pas de place dans cet ordre, elle peut aussi bien être la fille de nobles parents que de la domestique. L'identité est donc l'enjeu du roman : pas celle héritée, donnée une fois pour toutes, mais une identité qui doit se construire à travers les expériences vécues et les réflexions qu'elles suscitent.
Marivaux a créé un personnage complexe : Marianne exprime avec force une aspiration à la dignité, refuse de se prostituer, de subir un mariage qui ne lui convient pas, mais en même temps elle fonctionne aussi dans une forme de séduction, devenant de plus en plus consciente du désir qu'elle suscite, de celui qu'elle ressent et des avantages qu'elle peut en tirer. le roman pose donc une question au coeur des préoccupations de son époque : comment concilier une noblesse morale avec le désir. de l'objet de désir, Marianne devient un sujet désirant, avec toutes les ambiguïtés : le trouble que fait naître l'amour fait peur mais en même temps éveille une attente, est un plaisir.
Marivaux se joue des stéréotypes de genre : les femmes sont bavardes, d'où les digressions de l'héroïne. Mais il procède à une sorte d'inversion : Marianne ne se limite pas aux faits, elle les analyse, élargit le cadre, tire des généralités de ses expériences. C'est parce qu'elle réfléchit, qu'elle est une femme qui pense, une pensée différente des philosophes professionnels, car tirée de l'expérience, du monde réel et non abstraite et théorique. Cela lui fait contester le privilège masculin qui voudrait qu'ils soient les seuls capables de philosopher. Elle oppose ce faisant une pensée sensible à une pensée théorique, coupée du réel. Son outil de réflexion est l'introspection, par un retour sur soi elle tente de rendre intelligible ce qui lui est arrivé, et en tirer une vision plus générale.
Marianne est à la fois l'observateur et l'observé, mais l'art de Marivaux va plus loin. Même si la Marianne de 50 ans a une lucidité, une distance qui lui permet d'expliciter des choses qui n'étaient pas claires pour la jeune Marianne, elle peut se tromper, ne pas tout voir, ou ne pas le vouloir. le lecteur à son tour peut se livrer aux jeux des interprétations, voyant ce que le personnage ignore, ce qui est suggéré par l'auteur. le livre pointe ainsi les limites de la lucidité appliquée à soi-même.
La forme romanesque est pour Marivaux la forme idéale pour explorer l'humanité dans ses conditions les plus variées, dont les plus modestes, souvent ignorées par la littérature de son époque. Une lingère est observée au même titre qu'une grande dame. Il s'agit d'explorer le coeur humain, sans tenir compte du prestige social, l'être humain est le même quelle que soit sa position dans la société. A ce titre, une orpheline à l'origine incertaine est un sujet idéal.
Beaucoup de choses ont été écrites, supputées sur l'inachèvement du roman. le manque d'une fin « classique » n'est pas accidentelle : Marivaux aurait eu le temps de l'écrire. Mais d'une certaine manière, terminer le livre, dire précisément ce qui est arrivé à Marianne, dévoiler ses origines, irait à l'encontre du projet du roman. C'est en racontant son histoire que Marianne construit son identité, qu'elle la fantasme à certains moments : une identité mouvante, en perpétuel remaniement, jamais achevée.
Au-delà de tous ces éléments d'analyse, c'est un roman délicieux, même si Marianne pense, elle est malicieuse, a le sens de l'humour, ne se prend pas au sérieux. Marivaux manie le second degré à la perfection et maîtrise l'art de conter, de surprendre, de tenir son lecteur en haleine, tout cela dans un style merveilleux.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
Books en Stock :: Hey Billie Y'a quoi dans ta bibliothèque ? :: Littérature française :: Auteurs nés avant 1870
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
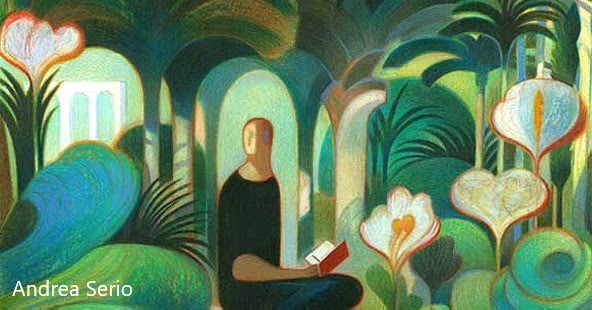
 Accueil
Accueil