Charles Péguy
Page 1 sur 1
 Charles Péguy
Charles Péguy
Charles Péguy (1873-1914)
Source : Vikidia
Charles Pierre Péguy est un écrivain français né le 7 janvier 1873 à Orléans et mort le 5 septembre 1914 à Villeroy (Seine-et-Marne).
Il est élevé par sa mère, rempailleuse de chaises, et sa grand-mère.
De 1879 à 1885, il va à l'école primaire annexe de l'École normale d'instituteurs d'Orléans où il apprend les nobles valeurs de « l'ancienne France » et se passionne pour le lyrisme des Châtiments de Victor Hugo.
Il obtient une bourse pour aller au lycée et obtient son baccalauréat en 1891, avec cette appréciation du directeur : un écolier comme Péguy ne doit jamais s'oublier ni donner l'exemple de l'irrévérence envers ses maîtres.
Il fait son service militaire puis est reçu au concours de l'École normale supérieure en 1894.
En 1897, il écrit un article dans la Revue socialiste, et Jeanne d'Arc, un mystère sur un thème qui le passionnera.
En 1898, révolté par l'antisémitisme, il participe aux affrontements entre dreyfusards et antidreyfusards, demande la révision du procès Dreyfus, et échoue à l'agrégation de philosophie. Il abandonne l'enseignement et se consacre à la littérature.
En 1900, Charles Péguy fonde la revue des Cahiers de la Quinzaine et adhère au socialisme de Jean Jaurès, dont il se détournera par la suite.
En 1910, il publie Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc.
Marié en 1897 à Charlotte-Françoise Baudouin (1879-1963), ils ont quatre enfants : Marcel, Germaine, Pierre et Charles-Pierre, son fils posthume. En 1912 l'un de ses fils a la parathyphoïde et Charles fait un pèlerinage pédestre à Chartres.
Lieutenant de réserve, il est mobilisé en août 1914 et tué le 5 septembre à la veille de la première bataille de la Marne.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Charles Péguy
Re: Charles Péguy
De la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe
En janvier 1900 Péguy se lance dans sa grande oeuvre ; Les cahiers de la Quinzaine. le premier numéro paraît le 5 janvier, la date de l'anniversaire de sa femme. Il y publiera l'essentiel de ses textes qui ne relèvent pas de la poésie. de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe appartient à la toute première époque des Cahiers, et paraîtra en trois parties, le 20 février, 20 mars et enfin le 5 avril.
Le titre fait irrésistiblement penser à l'expression utilisée par Danton dans un discours de 1792 : de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Cela donne tout de suite un avant goût de l'ironie qui sera toujours présente dans le texte de Péguy. Car, et j'avoue que cela a été une surprise pour moi, le texte est souvent drôle, espiègle, plein de second degré. le sujet de la maladie, et par opposition de la santé, n'est pas un thème dû au hasard. Péguy s'est toujours montré sensible au corps, il a assidûment pratiqué la marche, et il était très intéressé par les questions de santé publique, luttant par exemple contre la promotion de l'alcool, qui faisait des ravages dans les classes populaires à l'époque.
Le texte se base sur une une donnée réelle, une forte épidémie de grippe qui a eu lieu pendant l'hiver 1899-1900. Mais le projet de Péguy est de partir d'une expérience individuelle, et de tenter de la relier à une réflexion morale, politique, métaphysique. le texte, publié en trois parties, peut s'analyser en trois thématiques : celle de la maladie d'un corps individuelle, celle de la maladie socio-politique et celle de la maladie métaphysique.
Le texte se présente sous la forme d'un dialogue, entre un narrateur, que l'on aurait tendance à considérer comme Péguy lui-même (il évoque le travail sur la parution des Cahiers) et un homme présenté comme un « citoyen, docteur, socialiste, révolutionnaire, moraliste, internationaliste ». le terme de docteur ne renvoie pas à la médecine, mais au fait que l'homme est un savant, quelqu'un qui prétend détenir un savoir, entre autres politique. Mais en réalité, son rôle est surtout de faire avancer le dialogue.
La forme du dialogue n'est pas nouvelle bien entendu, on peut penser au dialogue socratique, cette forme a aussi été beaucoup utilisée dans la philosophie du XVIIIe siècle. Péguy l'a déjà utilisé. En plus de donner une forme dynamique et attrayante au texte, le discours à plusieurs voix permet d'introduire dans la pensée une contradiction, un échange, de mieux cheminer vers une pensée juste, ce qui est le but premier de Péguy. le dialogue permet d'introduire des nuances, le complexe, faire entrevoir les failles du réel.
Nous partons donc de la maladie individuelle du narrateur, le docteur venant pour s'informer. Péguy se met en scène, décrit sa maladie, les symptômes, la convalescence, une petite rechute, la manière dont cette maladie influe sur la parution des Cahiers en cours. Ce qui nous permet d'entrevoir les coulisses de la revue en train de se faire.
Mais très rapidement le point de vue n'est plus qu'individuel : le narrateur s'interroge sur la transmission, sur la manière dont la grippe se répand, et donc sur un aspect social de la maladie. Et la maladie de Péguy a un impact sur le travail des personnes qui collaborent avec lui, qui doivent faire en partie à sa place. Dans une épidémie, le malade n'est jamais seul. Même si chacun vit sa maladie à sa façon, y fait face d'une manière qui lui est propre. C'est ce qui évoqué, par des exemples, d'un ami de Péguy mort jeune, entre autres. Tout cela amène aussi la question du mental sur la santé, le lien entre l'esprit et le corps. Si Péguy est malade à ce moment-là précisément, c'est que peut-être qu'il y a des raisons à cela.
Ces raisons que Péguy a d'être malade, introduisent la thématique de la maladie socio-politique. En effet, le lancement des Cahiers au début de l'année 1900 marque une sorte de rupture avec les organisations socialistes, suite au congrès de 1899. Ce congrès a été pour Péguy une grosse déception, à cause des rivalités et ambitions, compromis boiteux et renoncements, hypocrisies, sectarisme. La maladie individuelle mène ainsi à la une maladie du socialisme, les Cahiers étant en quelque sorte un remède possible. Il s'agissait pour Péguy de faire passer quelques idées socialistes simples, et de cette manière faire progresser la révolution par des adhésions individuelles progressives, une révolution par étapes, et non brutale et sanguinaire. Car le mal touche non seulement le socialisme, mais aussi tous les partis politiques, le régime parlementaire. Au-delà du politique, la maladie touche aussi l'institution de l'église. de même les conquêtes militaires et coloniales et les exactions et atrocités qui les accompagnent sont un symptôme du mal. Des pays comme la France qui se présentent comme libéraux et démocratiques se comportent d'une manière honteuse, que l'on peut considérer comme une maladie sociale auquel il faut trouver un remède. L'humanité entière est concernée, c'est l'Homme en tant que tel qui est malade.
Ce qui amène l'auteur à la maladie métaphysique, terme que Péguy réhabilite (alors qu'à l'époque où il écrit ce texte, il est encore agnostique). Pour lui, poser la mortalité de l'homme, c'est aussi de la métaphysique. Ce qui a précédé sur les conquêtes, introduit la notion de la mort de l'humanité : les guerres, les massacres, le travail abrutissant imposé à certains, l'alcoolisme etc font que l'homme devient acteur de sa propre destruction. La grippe d'un individu nous amène donc à réfléchir à la fin de l'humanité. Pour construire cette réflexion, Péguy convoque des grands penseurs, toujours dans l'esprit de dialogue, de construction à plusieurs. Renan, qu'il rejette en grande partie, à cause d'une part trop importante de spéculations abstraites, car Péguy ne dissocie jamais la métaphysique du corps, du tangible. Elle ne doit pas être une fuite du présent.
Enfin, Péguy fait une grande place à Pascal, qui l'aide à réfléchir sur comment vivra sa maladie. Cette dernière devient une sorte d'épreuve de vérité, qui oblige à tomber le masque, permet une prise de conscience, donne une plus grande lucidité, permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, en nous sortant de l'urgence du quotidien.
Sous une apparence au départ presque anecdotique, pleine d'ironie, amusante, c'est un texte très dense et d'une grande profondeur, qui nécessite sans doute plusieurs lectures, et des références qui permettent de mieux l'appréhender. Il m'a en tous les cas permis de mieux comprendre l'intérêt porté à Péguy, et les citations et références que de nombreux auteurs y font. Se plonger dans cette oeuvre reste malgré tout une entreprise complexe, et qui demande incontestablement un véritable investissement.
En janvier 1900 Péguy se lance dans sa grande oeuvre ; Les cahiers de la Quinzaine. le premier numéro paraît le 5 janvier, la date de l'anniversaire de sa femme. Il y publiera l'essentiel de ses textes qui ne relèvent pas de la poésie. de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe appartient à la toute première époque des Cahiers, et paraîtra en trois parties, le 20 février, 20 mars et enfin le 5 avril.
Le titre fait irrésistiblement penser à l'expression utilisée par Danton dans un discours de 1792 : de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Cela donne tout de suite un avant goût de l'ironie qui sera toujours présente dans le texte de Péguy. Car, et j'avoue que cela a été une surprise pour moi, le texte est souvent drôle, espiègle, plein de second degré. le sujet de la maladie, et par opposition de la santé, n'est pas un thème dû au hasard. Péguy s'est toujours montré sensible au corps, il a assidûment pratiqué la marche, et il était très intéressé par les questions de santé publique, luttant par exemple contre la promotion de l'alcool, qui faisait des ravages dans les classes populaires à l'époque.
Le texte se base sur une une donnée réelle, une forte épidémie de grippe qui a eu lieu pendant l'hiver 1899-1900. Mais le projet de Péguy est de partir d'une expérience individuelle, et de tenter de la relier à une réflexion morale, politique, métaphysique. le texte, publié en trois parties, peut s'analyser en trois thématiques : celle de la maladie d'un corps individuelle, celle de la maladie socio-politique et celle de la maladie métaphysique.
Le texte se présente sous la forme d'un dialogue, entre un narrateur, que l'on aurait tendance à considérer comme Péguy lui-même (il évoque le travail sur la parution des Cahiers) et un homme présenté comme un « citoyen, docteur, socialiste, révolutionnaire, moraliste, internationaliste ». le terme de docteur ne renvoie pas à la médecine, mais au fait que l'homme est un savant, quelqu'un qui prétend détenir un savoir, entre autres politique. Mais en réalité, son rôle est surtout de faire avancer le dialogue.
La forme du dialogue n'est pas nouvelle bien entendu, on peut penser au dialogue socratique, cette forme a aussi été beaucoup utilisée dans la philosophie du XVIIIe siècle. Péguy l'a déjà utilisé. En plus de donner une forme dynamique et attrayante au texte, le discours à plusieurs voix permet d'introduire dans la pensée une contradiction, un échange, de mieux cheminer vers une pensée juste, ce qui est le but premier de Péguy. le dialogue permet d'introduire des nuances, le complexe, faire entrevoir les failles du réel.
Nous partons donc de la maladie individuelle du narrateur, le docteur venant pour s'informer. Péguy se met en scène, décrit sa maladie, les symptômes, la convalescence, une petite rechute, la manière dont cette maladie influe sur la parution des Cahiers en cours. Ce qui nous permet d'entrevoir les coulisses de la revue en train de se faire.
Mais très rapidement le point de vue n'est plus qu'individuel : le narrateur s'interroge sur la transmission, sur la manière dont la grippe se répand, et donc sur un aspect social de la maladie. Et la maladie de Péguy a un impact sur le travail des personnes qui collaborent avec lui, qui doivent faire en partie à sa place. Dans une épidémie, le malade n'est jamais seul. Même si chacun vit sa maladie à sa façon, y fait face d'une manière qui lui est propre. C'est ce qui évoqué, par des exemples, d'un ami de Péguy mort jeune, entre autres. Tout cela amène aussi la question du mental sur la santé, le lien entre l'esprit et le corps. Si Péguy est malade à ce moment-là précisément, c'est que peut-être qu'il y a des raisons à cela.
Ces raisons que Péguy a d'être malade, introduisent la thématique de la maladie socio-politique. En effet, le lancement des Cahiers au début de l'année 1900 marque une sorte de rupture avec les organisations socialistes, suite au congrès de 1899. Ce congrès a été pour Péguy une grosse déception, à cause des rivalités et ambitions, compromis boiteux et renoncements, hypocrisies, sectarisme. La maladie individuelle mène ainsi à la une maladie du socialisme, les Cahiers étant en quelque sorte un remède possible. Il s'agissait pour Péguy de faire passer quelques idées socialistes simples, et de cette manière faire progresser la révolution par des adhésions individuelles progressives, une révolution par étapes, et non brutale et sanguinaire. Car le mal touche non seulement le socialisme, mais aussi tous les partis politiques, le régime parlementaire. Au-delà du politique, la maladie touche aussi l'institution de l'église. de même les conquêtes militaires et coloniales et les exactions et atrocités qui les accompagnent sont un symptôme du mal. Des pays comme la France qui se présentent comme libéraux et démocratiques se comportent d'une manière honteuse, que l'on peut considérer comme une maladie sociale auquel il faut trouver un remède. L'humanité entière est concernée, c'est l'Homme en tant que tel qui est malade.
Ce qui amène l'auteur à la maladie métaphysique, terme que Péguy réhabilite (alors qu'à l'époque où il écrit ce texte, il est encore agnostique). Pour lui, poser la mortalité de l'homme, c'est aussi de la métaphysique. Ce qui a précédé sur les conquêtes, introduit la notion de la mort de l'humanité : les guerres, les massacres, le travail abrutissant imposé à certains, l'alcoolisme etc font que l'homme devient acteur de sa propre destruction. La grippe d'un individu nous amène donc à réfléchir à la fin de l'humanité. Pour construire cette réflexion, Péguy convoque des grands penseurs, toujours dans l'esprit de dialogue, de construction à plusieurs. Renan, qu'il rejette en grande partie, à cause d'une part trop importante de spéculations abstraites, car Péguy ne dissocie jamais la métaphysique du corps, du tangible. Elle ne doit pas être une fuite du présent.
Enfin, Péguy fait une grande place à Pascal, qui l'aide à réfléchir sur comment vivra sa maladie. Cette dernière devient une sorte d'épreuve de vérité, qui oblige à tomber le masque, permet une prise de conscience, donne une plus grande lucidité, permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, en nous sortant de l'urgence du quotidien.
Sous une apparence au départ presque anecdotique, pleine d'ironie, amusante, c'est un texte très dense et d'une grande profondeur, qui nécessite sans doute plusieurs lectures, et des références qui permettent de mieux l'appréhender. Il m'a en tous les cas permis de mieux comprendre l'intérêt porté à Péguy, et les citations et références que de nombreux auteurs y font. Se plonger dans cette oeuvre reste malgré tout une entreprise complexe, et qui demande incontestablement un véritable investissement.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4799
Date d'inscription : 29/11/2016
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
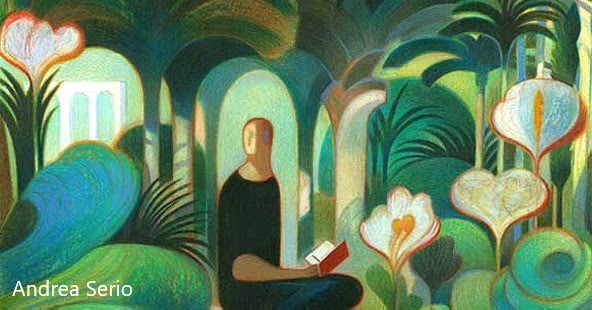
 Accueil
Accueil