Georg Büchner
Page 1 sur 1
 Georg Büchner
Georg Büchner
Georg Büchner (1813-1837)
Source : Radio-France
Georg Büchner est né en 1813 et mort en 1837, à l'âge de vingt-trois ans. Il avait participé à l'agitation révolutionnaire des années 1830, écrit trois pièces de théâtre qui allaient bouleverser la littérature dramatique, une nouvelle qui est un chef d'oeuvre, étudié la philosophie, soutenu une thèse de biologie et enseigné l'anatomie à l'université. Il passe son enfance en Allemagne dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt, où résident ses parents. En 1831, il s'inscrit à la faculté de médecine de l'université de Strasbourg. Là, il découvre l'action politique. On sait par des témoignages qu'il fréquente des organisations clandestines républicaines fortement marquées par les idées les plus radicales de la Révolution française, notamment la Société des Droits de l'Homme et du Citoyen . L'objectif de ces organisations est de déstabiliser le nouveau pouvoir - instauré après la révolution de juillet 1830 - par de l'agitation souterraine et des actions violentes. De retour en Allemagne en octobre 1833, Büchner, imprégné des principes républicains, fonde d'abord à Gießen, où il poursuit ses études, puis à Darmstadt, deux Sociétés des Droits de l'Homme sur le modèle de l'association française. Désapprouvant les actions violentes qu'il trouve inutiles et suicidaires, il préfère utiliser la misère matérielle comme levier révolutionnaire et, pour ce faire, s'adresser à la conscience du peuple. En collaboration avec le pasteur Weidig, il rédige Le Messager hessois , un libelle destiné aux paysans. L'opération est un échec. Suite à une dénonciation, la plupart des organisateurs sont arrêtés. La répression est sévère : persécutions, interrogatoires, longues peines d'emprisonnement. Büchner échappe de justesse, il se réfugie chez ses parents, et c'est là, dans la crainte constante d'être convoqué devant un juge, qu'il rédige en janvier 1835 les quatre actes de La Mort de Danton . L'oeuvre à peine terminée, il doit s'enfuir, et se réfugie à Strasbourg : il mène désormais la vie d'un exilé politique. Dans la capitale alsacienne, il poursuit ses études, abandonnant la médecine pour s'orienter vers la biologie. Parallèlement, il se consacre à l'étude de la philosophie, lit Descartes, Spinoza, la philosophie grecque, et pour gagner sa vie il traduit en allemand Lucrèce Borgia et Marie Tudor de Victor Hugo. Ayant eu connaissance de notes inédites du pasteur Oberlin sur le séjour du poète Jacob Michael Lenz dans le village alsacien de Waldersbach, Büchner écrit, entre avril et novembre 1835, la nouvelle Lenz , dans la quelle il décrit une avec une étonnante acuité les troubles psychiques et les souffrances du jeune poète ; ce texte est aussi pour lui l'occasion de prendre parti en faveur d'une littérature qui rompe avec l'idéalisme allemand pour retrouver la réalité de l'existence humaine dans sa complexité et son foisonnement. En mai 1836, il termine sa thèse, Mémoire sur le système nerveux du barbeau , puis il écrit une première version de Léonce et Léna , destinée à un concours de comédies organisé par la maison d'édition Cotta. Le 3 septembre, il est reçu docteur à l'université de Zurich. Dans les mois qui suivent, il travaille sur Woyzeck , sur une seconde version de Léonce et Léna , et peut-être sur un drame aujourd'hui disparu, L'Arétin . Le 18 octobre, il s'installe à Zurich et, dès la mi-novembre, commence ses cours d'anatomie comparée à l'université. Fin janvier 1837, il tombe malade du typhus et meurt le 19 février, laissant son drame Woyzeck inachevé. En 1850, son frère Ludwig Büchner publie ses Oeuvres posthumes sans Woyzeck . La pièce sera éditée en 1875 sous le titre erroné Wozzeck , repris par Alban Berg pour son opéra en 1929.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4791
Date d'inscription : 29/11/2016
 Re: Georg Büchner
Re: Georg Büchner
La mort de Danton
Écrite en 1835, alors que l'auteur a à peine 22 ans, la pièce est publiée la même année, mais elle ne connaîtra sa première représentation sur scène qu'en 1902. Il faut dire que l'auteur est mort deux ans après, et que ses activités révolutionnaires le rendaient suspect aux autorités politiques de son temps. Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle qu'il est reconnu comme un écrivain important, grâce en particulier à sa pièce pourtant inachevée, Woyzeck, et à La mort de Danton.
L'action de la mort de Danton se déroule en 1794, pendant la Terreur. La France est en guerre, la Révolution fait face aux armées étrangères ainsi qu'à des résistances intérieures, comme la guerre de Vendée. Mais il y a aussi les luttes de factions parmi les révolutionnaires. L'exécution des Girondins en 1793, est suivie au début de l'année 1794 par celle des hébertistes. Les proches de Danton, ou les indulgents, sentent monter le danger autour de leurs personnes, ils pourraient être les suivants sur la listes du Comité du Salut publique dominé par Robespierre. Ils tentent de mettre en garde Danton, et lui faire reprendre l'offensive. Mais ce dernier n'est pas décidé à réagir, perdu dans ses plaisirs, dans une forme d'indolence, teintée de culpabilité. L'histoire est en marche, Robespierre et Saint-Just sont décidés à en finir avec ceux qu'ils trouvent trop indécis.
Il y a en quelque sorte trois forces en présence. Danton et ses amis, Robespierre et ceux qui l'appuient, et le peuple. Ce dernier est toutefois en retrait, plus spectateur que véritablement acteur, et surtout il se laisse manipuler, par celui qui sait toucher la bonne corde au bon moment. Même si ce qui se passe est censé se faire en son nom. L'opposition entre les deux factions politiques est plus une opposition entre deux personnalités que vraiment deux pensées politiques en tant que telles. Robespierre qui revendique une vertu poussée à son extrême, refuse toute forme de plaisir, de bonheur, revendique un ascétisme extrême qui frise le masochisme. A l'opposé, Danton vit dans la recherche du plaisir à tout prix, dans une forme de fuite en avant, qui ressemble à de l'auto-destruction. Il se refuse de réagir, attend, répète « ils n'oseront pas ». Ne se met en branle que lorsqu'il est trop tard. A l'opposé Robespierre a tout d'une machine implacable, qui poursuit son but sans relâche, sans aucun doute sur sa légitimité.
C'est un objet étrange que cette pièce, avec ses personnages innombrables, ses différentes thématiques. Elle laisse une sensation de chaos, sans fournir de fil directeur. Les événements représentés semblent échapper à la maîtrise des hommes, la machine une fois lancée, ne peut plus être stoppée. La violence est par moments insupportable, suffocante, sans alternative. Une question de sens se pose. Parce que, bien que l'auteur reprenne des citations des personnages historiques qu'il met en scène, il n'y a pas à mon sens de véritable vision politique qui apparaisse clairement. Tout semble confus, y compris pour ceux qui sont censés mener les événements.
Mais dépeindre cette confusion, cette difficulté à mettre en place des institutions, un fonctionnement social, définir un objectif commun, était peut-être le but de l'auteur.
Écrite en 1835, alors que l'auteur a à peine 22 ans, la pièce est publiée la même année, mais elle ne connaîtra sa première représentation sur scène qu'en 1902. Il faut dire que l'auteur est mort deux ans après, et que ses activités révolutionnaires le rendaient suspect aux autorités politiques de son temps. Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle qu'il est reconnu comme un écrivain important, grâce en particulier à sa pièce pourtant inachevée, Woyzeck, et à La mort de Danton.
L'action de la mort de Danton se déroule en 1794, pendant la Terreur. La France est en guerre, la Révolution fait face aux armées étrangères ainsi qu'à des résistances intérieures, comme la guerre de Vendée. Mais il y a aussi les luttes de factions parmi les révolutionnaires. L'exécution des Girondins en 1793, est suivie au début de l'année 1794 par celle des hébertistes. Les proches de Danton, ou les indulgents, sentent monter le danger autour de leurs personnes, ils pourraient être les suivants sur la listes du Comité du Salut publique dominé par Robespierre. Ils tentent de mettre en garde Danton, et lui faire reprendre l'offensive. Mais ce dernier n'est pas décidé à réagir, perdu dans ses plaisirs, dans une forme d'indolence, teintée de culpabilité. L'histoire est en marche, Robespierre et Saint-Just sont décidés à en finir avec ceux qu'ils trouvent trop indécis.
Il y a en quelque sorte trois forces en présence. Danton et ses amis, Robespierre et ceux qui l'appuient, et le peuple. Ce dernier est toutefois en retrait, plus spectateur que véritablement acteur, et surtout il se laisse manipuler, par celui qui sait toucher la bonne corde au bon moment. Même si ce qui se passe est censé se faire en son nom. L'opposition entre les deux factions politiques est plus une opposition entre deux personnalités que vraiment deux pensées politiques en tant que telles. Robespierre qui revendique une vertu poussée à son extrême, refuse toute forme de plaisir, de bonheur, revendique un ascétisme extrême qui frise le masochisme. A l'opposé, Danton vit dans la recherche du plaisir à tout prix, dans une forme de fuite en avant, qui ressemble à de l'auto-destruction. Il se refuse de réagir, attend, répète « ils n'oseront pas ». Ne se met en branle que lorsqu'il est trop tard. A l'opposé Robespierre a tout d'une machine implacable, qui poursuit son but sans relâche, sans aucun doute sur sa légitimité.
C'est un objet étrange que cette pièce, avec ses personnages innombrables, ses différentes thématiques. Elle laisse une sensation de chaos, sans fournir de fil directeur. Les événements représentés semblent échapper à la maîtrise des hommes, la machine une fois lancée, ne peut plus être stoppée. La violence est par moments insupportable, suffocante, sans alternative. Une question de sens se pose. Parce que, bien que l'auteur reprenne des citations des personnages historiques qu'il met en scène, il n'y a pas à mon sens de véritable vision politique qui apparaisse clairement. Tout semble confus, y compris pour ceux qui sont censés mener les événements.
Mais dépeindre cette confusion, cette difficulté à mettre en place des institutions, un fonctionnement social, définir un objectif commun, était peut-être le but de l'auteur.
_________________
Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer. (Oscar Wilde)

Arabella- Messages : 4791
Date d'inscription : 29/11/2016
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
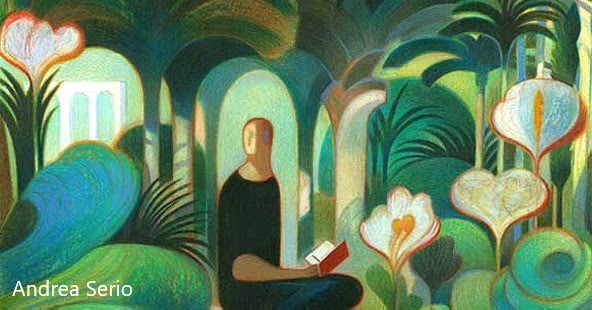
 Accueil
Accueil